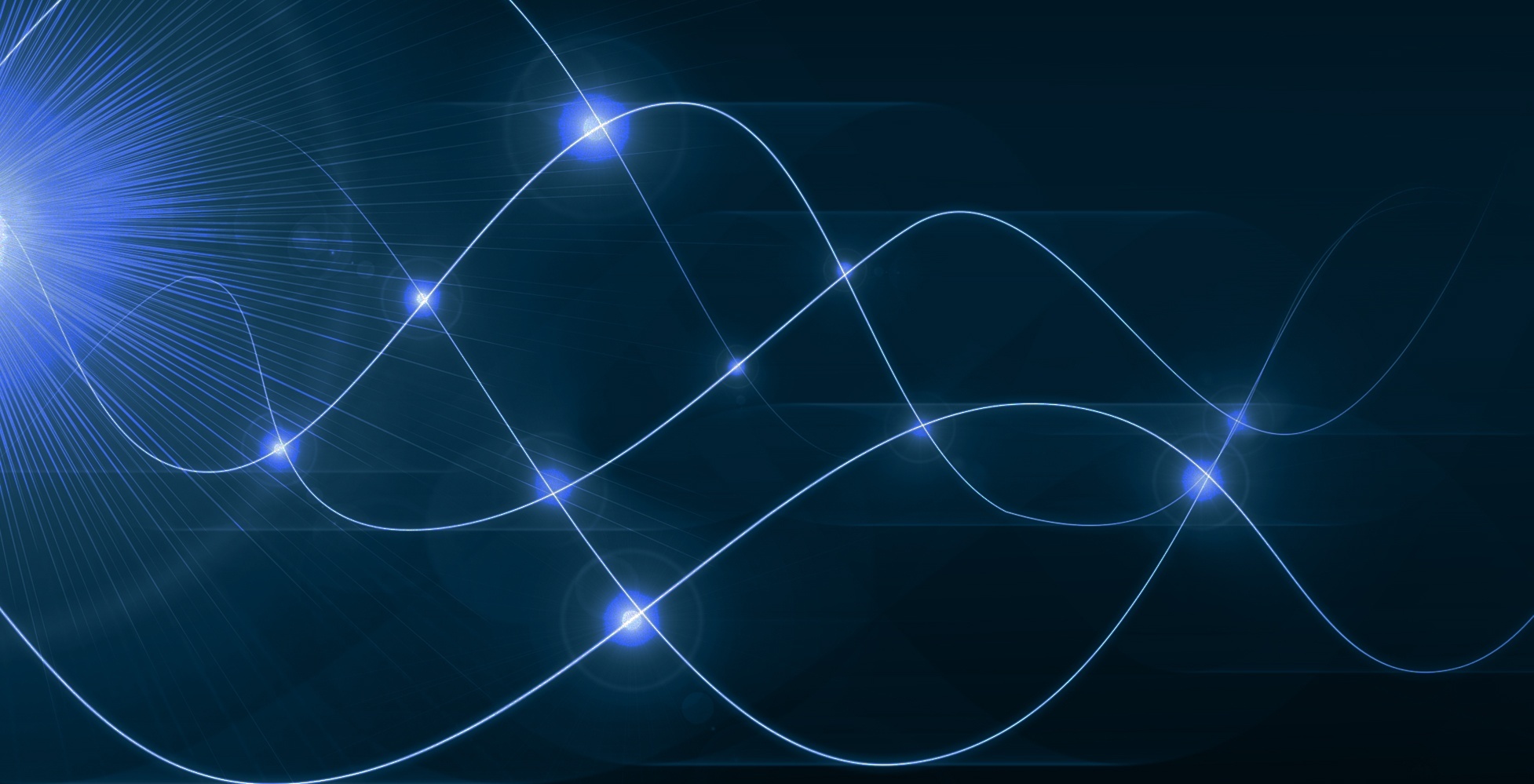The originality of M2P2 lies in its research themes in the fields of Computational Fluid Mechanics and Process Engineering through 6 team.
Research in mechanics and modeling is combined with strong methodological development around calculation codes for the simulation of natural and industrial flows.
In the field of process engineering, research focuses on the development of innovative processes, as well as on the study of the issues at stake in these processes, as part of a strong contractual activity.
3 cross-disciplinary axes complete this matrix structure, exploring new avenues of research on innovative and topical projects, taking advantage of cross-team skills.